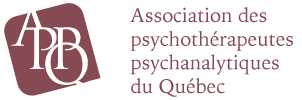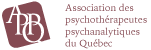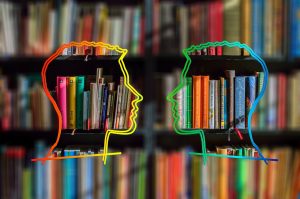Soirées d'échanges et de débats
Rappelons au préalable le sens que prend l'expression « soirée-débat » à l'APPQ. Dans notre esprit, il ne s'agit pas de polariser les positions sur un sujet donné mais plutôt d'énoncer des perspectives différentes voire des points de vue divergents — points de désaccord ou de dissonance — entre les discours présentés afin de susciter la réflexion, la mise en commun, la discussion.
C'est pourquoi, outre nos partenaires associatifs habituels — cliniciens, psychologues, psychothérapeutes psychanalytiques, psychanalystes, psychiatres, travailleurs sociaux — l'APPQ valorise et favorise l'idée de faire entendre une diversité de voix sur différents sujets d'actualité. Elle offre son hospitalité à des professionnels de différents horizons disciplinaires — sciences, sciences humaines et sociales, arts et lettres. Une rencontre inter-multi-disciplinaire comme des petites lumières dans la nuit.
Les soirées-débats ont lieu deux fois par année à l'automne et à l'hiver. Elles sont animées par Mme Chantal Saint-Jarre, membre de l'APPQ.
Les soirées-débats reprendront à l'automne 2024.
Les dernières soirées-débats avaient pour thème les mémoires collectives dans les communautés autochtones. Voici le texte d'ouverture de la première soirée, de même que les présentations des quatre invité.e.s:
Dre Judith Morency, Ph.D., psychologue est activement engagée depuis plus de 30 ans dans la pratique clinique et communautaire auprès des Premières Nations, en particulier la nation innue et les nations anishnabe et atikamekw avec qui elle a développé et mis en oeuvre plusieurs programmes de prévention et d’intervention communautaire alliant des approches thérapeutiques culturelles et contemporaines pour remédier, entre autres, à la violence sexuelle envers les enfants.
Barbara Kaneratonni Diabo, chorégraphe / danseuse primée depuis plus de 30 ans, est Kanien'keha:ka (Mohawk) de Kahnawake et vit maintenant à Tiohtià:ke / Montréal. Elle est directrice artistique et fondatrice du A'nó:wara Dance Theatre, où elle se spécialise dans la création d'œuvres qui mettent en valeur des thèmes, des histoires, des perspectives autochtones. Son travail a été vu partout au Canada et à l'étranger. Elle travaille également avec diverses organisations pour aider à éduquer les autres, créer des espaces sûrs et soutenir les artistes autochtones du monde entier.
Nancy Etok est directrice adjointe de l'école Ulluriaq de Kangiqsualujjuaq. Elle a occupé divers postes tels qu’enseignante, conseillère étudiante et administratrice. Elle est l'une des fondatrices de la Maison de la famille Qarmaapik. Madame Etok a également fait partie du comité consultatif de l'équipe d'autodétermination du Nunavik. De plus, elle est membre du conseil d'administration de Pauktutiit. Madame Etok consacre une bonne partie de son temps à la promotion de la croissance des Inuit sur la base d’une fondation culturelle solide.
David Poulin-Latulippe, M.A., est psychologue clinicien auprès des enfants, des familles et des adultes en cabinet privé à Sherbrooke. Il supervise des étudiants du programme de doctorat en psychologie clinique de l’enfant, de l’adolescent et des parents, et est aussi chargé de cours pour le Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke. Monsieur Poulin-Latulippe est l’instigateur d’un projet pilote de psychothérapie pour enfants utilisant le jeu dans le Grand Nord québécois. Il a aussi été psychologue pour la Maison de la famille Qarmaapik dans la communauté de Kangiqsualujjuaq. Il est le concepteur et l’intervenant pivot dans différents projets de recherche réalisés dans le Nunavik en collaboration avec l’Université de Sherbrooke. Les intérêts de recherche de Monsieur Poulin-Latulippe portent principalement sur la psychologie intersubjective et l’approche phénoménologique en psychothérapie.